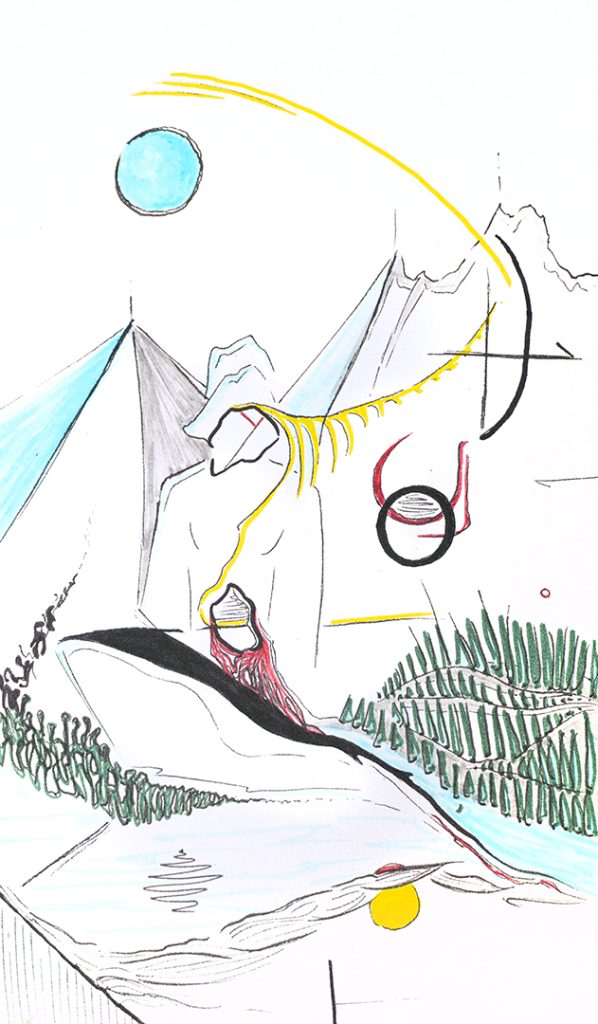Dans le Grand Nord
Les pales de l’hélicoptère soulevaient une poussière jaunâtre. Le pilote fit les dernières lectures des cadrans. Il leva sa grosse tête rougeaude de lutteur ébahi vers le petit groupe de personnes qui attendaient à une vingtaine de mètres. Cinq passagers. Le reste de l’équipe demeurait au sol jusqu’au prochain voyage. Il leva un pouce en l’air et d’une main invita les passagers à monter dans l’appareil. Deux passagers se dirigèrent vers la porte ouverte derrière le pilote. Il pointa vers l’avant de l’appareil. Passez par-là, intima-t-il, à l’endroit des autres passagers. Deux d’entre eux contournèrent le nez de l’hélico. Ne restait que Billy, un gringalet qui avait obtenu la job avec l’équipe de géologues grâce aux relations de son père. Dire qu’il était peu apprécié par les membres de l’équipe serait un euphémisme. Pourtant, c’est lui qui avait sauvé la vie de Grigori en utilisant son épipen pour atténuer une grave allergie alimentaire. Le pilote s’impatientait. Billy avança vers l’appareil. Un coup de vent souleva encore plus de poussière et Billy fut momentanément aveuglé. Il cessa de marcher, le temps d’y voir quelque chose. Il était tout contre l’appareil, mais du mauvais côté. Désorienté, il se remit en marche, tête baissée, une main devant les yeux. Le vent semblait souffler plus fort. Il remarqua du coin de l’œil les membres de l’équipe qui gesticulaient comme des pantins sur les amphétamines et faisaient des moulinets frénétiques avec leurs bras. Tous pointaient vers la queue de l’hélicoptère. Billy leva la tête. Il était à trente centimètres du rotor de queue. Pétrifié, il lui fallut plusieurs secondes pour réagir. Il rebroussa chemin, contourna le nez de l’appareil et monta dans la cabine. Le pilote lui lança un regard meurtrier. « Crisse de trou de cul. Un vrai fils de boss! »
Un vol
Bernard Beige avait attendu cette promotion pendant des années. Il avait gravi tous les échelons. En nouant sa cravate, il se remémora avec un petit pincement son parcours. Il avait débuté dans la rue, à servir de la soupe chaude aux itinérants. Puis il avait été surveillant dans un centre de sans-abris, responsable des popotes ambulantes, gestionnaire d’un centre de jour. Maintenant directeur des Services sociaux de toute la région. Un poste de haut fonctionnaire au ministère était prévisible dans un proche avenir. Il serra sa ceinture d’un cran supplémentaire. Le régime fonctionnait. Il passa machinalement la main à son auriculaire gauche, qui le démangeait depuis quelques jours et rajusta la chevalière qui avait tendance à tomber. Il trouva curieux que le régime fasse aussi maigrir les doigts.
Ce matin-là, à titre de directeur nouvellement nommé, il recevait le CA d’une Fondation désirant proposer un partenariat dans le domaine de la santé mentale chez les démunis. Échanges polis et platitudes de circonstances. « Notre mission, nos valeurs, bla bla … » La réunion fut brève. Tous quittèrent la salle, sauf une femme, grande et droite, qui s’approcha de Beige.
– J’ai remarqué votre chevalière. D’où la tenez-vous?
– Pardon?
Elle le fixait intensément. Elle savait.
Son diplôme de travailleur social en poche, Beige arpentait les rues depuis des mois à la recherche des plus rétifs, de ceux qui ne voulaient rien savoir du système. Il y avait ce type aux allures snob malgré son aspect dépenaillé. Il puait. Je m’appelle Personne, disait-il. Il portait un tas de breloques autour du cou et des bagues à chaque doigt. Il y avait une chevalière, avec un motif de flamme s’élevant d’une pierre tombale. C’était finement gravé. Un matin de grand froid, Beige avait trouvé le type gelé, raide mort. Il lui subtilisa la chevalière et commença à la porter quelques mois plus tard.
– Qui vous l’a donnée?
– Personne. Il se faisait appeler Personne.
Un sourire cruel traversa le visage de la femme.
– Personne, en effet. Tout aussi paumé qu’il était, mon frère Patrick était passionné depuis l’enfance par l’Odyssée et Ulysse, qui se faisait appeler Personne pour échapper à Polyphème, le cyclope. Permettez.
Elle lui prit la main gauche avec fermeté.
– Cette flamme montant d’un tombeau, c’est notre blason familial depuis des générations. Vous l’avez volée à Patrick. Jamais il ne l’aurait donnée. C’était son trésor. Il disait que c’était la bague d’Ulysse.
Beige était confus, il bégaya. Elle tendit la main.
– Donnez.
Le ton était sans appel.
– Elle ira dans sa tombe. Nous ferons exhumer.
– Sa tombe? On n’avait pas réclamé son corps. On s’apprêtait l’envoyer à la Faculté de médecine pour les cours de dissection.
– Non. J’ai récupéré son corps in extremis et j’ai bien vu qu’il n’avait plus la chevalière. Vous êtes un voleur, monsieur Beige.
Un enfant
L’enfant tourne autour de la table de cuisine. Le plateau de biscuits fraîchement sorti du four trône sur le joli napperon au milieu de la table. Ça sent bon, il imagine déjà les pépites de chocolat fondre sur sa langue. Il salive. Il lève le bras pour tendre la main, mais ça bloque. Ça ne veut pas. Seulement un biscuit, là, celui qui est juste sur le bord du plateau et que maman n’a probablement pas vu, parce qu’il est plus petit que les autres, comme le chiot esseulé qu’il avait vu quelques semaines auparavant sur un trottoir. Il avait supplié ses parents. Il faut le secourir. Les parents n’avaient pas répondu. Le biscuit … Le désir est fort. La voix dit non. Il remonte à sa chambre. Elle est dans un ordre impeccable, ce n’est pas comme la chambre de Vivianne, la grande sœur, qui laisse tout traîner. Si au moins son désordre était joli. Ici, tout est parfait. Non, il y a un pli sur la couette. Vite, tirer sur un côté, puis sur une autre. Voilà. Ah, il y a peut-être de la poussière sous le lit. Il faudrait l’enlever, puis bien ranger les camions, sinon … L’arôme invitant des biscuits est monté à la chambre et interrompt ses atermoiements. Il descend à la cuisine. Papa est encore dans le garage, maman dans le sous-sol. Il a vu le chat de la voisine tourner autour d’une souris, l’attraper, la lancer en l’air pour la rattraper et la relancer aussitôt. Non, il ne faut pas faire ça avec le biscuit. S’il en prend un, personne ne le saura. Oui, quelqu’un le saura. Lui. Ce sera délicieux dans sa bouche pendant deux minutes au plus, mais il sait qu’il y pensera toute la journée, en se couchant, en se réveillant. Il y a beaucoup de choses comme ça qu’il transporte dans sa tête d’une journée à l’autre. Des choses qu’il aurait voulues, mais qu’il n’a pas pu. Il tourne autour de la table en geignant et en tapant des pieds. La mère monte. « Mais ça va pas la tête! Tiens, prends un biscuit et va devant la télé. J’ai du travail à faire. » Il s’installe devant un épisode de la Pat Patrouille, le biscuit en main, il ne le mange pas. Ça ne devait pas se passer comme ça. Il aurait voulu le prendre lui-même, car le soir venu il aurait pensé au biscuit. Il aurait été à la fois content et mécontent. Comme quand il avait touillé du bout de la langue le trou dans la gencive, après avoir perdu une dent en tombant sur le carrelage. Ça faisait mal et c’était bon. Les deux en même temps.
Un grand sec
Longiligne, démarche désarticulée, toujours en train de remonter ses lunettes, habillé style mai 1968 avec col roulé, veston à carreaux, jeans à pattes d’éléphant, avec un éternel journal sous le bras, le type m’intriguait. Je n’avais pas envie de le connaître plus que ça, mais je ne pouvais m’empêcher de l’observer lorsqu’il passait devant mon animalerie, dans le centre d’achats de Gatineau. Il avait une horloge coincée dans le cerveau. Il passait toujours à 13 h 05, quand je rouvrais la boutique après ma pause midi. Pas une seule fois il n’a tourné la tête dans ma direction. Il semblait sourd à ce qui l’entourait. Les chiots dans la vitrine l’avaient remarqué et ils aboyaient plus fort quand il passait devant. Il devait travailler au nouveau centre d’emploi que le gouvernement venait d’ouvrir au bout du couloir. Avec son allure soixante-huitarde, il semblait tout frais sorti d’un musée. Je n’arrivais pas à lui donner un âge convenable à cause de son accoutrement. Quel journal pouvait-il bien lire? Il ne restait plus que deux quotidiens imprimés dans toute la province, des quotidiens populaires qui ne correspondaient pas à son genre. Puis un jour, il a cessé de passer devant ma boutique. Trois mois plus tard, je l’ai croisé à une réception donnée par un petit éditeur local. Outre ma passion pour les animaux de compagnie, je me targuais d’un certain talent littéraire et je venais de publier un opuscule chez l’éditeur. Il était là. C’est lui qui m’a reconnu en premier.
– Ah, c’est vous le type de l’animalerie. J’ai lu votre … livre … enfin, si on peut appeler ça un livre. Soixante pages, c’est un peu … c’est maigre. Mais il y a de jolies trouvailles, notamment lorsque vous comparez les chiots à des saucissons en fourrures. Je déteste les chiens.
– Vous écrivez?
– J’écris tout le temps, partout.
– Vous avez publié?
– Pas encore. Je travaille sur un magnum opus. Deux mille pages. Dans mon récit, je dis bien récit et non roman, mon protagoniste est un tardigrade qui parcourt chaque circuit mental d’Elon Musk. Il y a de la matière, croyez-moi. Je prévois déjà des annexes.
Ô chocolat
– Le fleuve fait même pas trois cents mètres de largeur à cet endroit-là. En plus, l’île est inhabitée et il n’y a rien de l’autre côté, sur la rive américaine. Regardez.
C’était la Toussaint. Un vent d’ouest très doux avait calmé les morsures d’un hiver hâtif. Gendron mit son long doigt sur la carte étalée sur la table.
– Le bateau est caché au bout de l’île Iroquois, sous une bâche. Pas visible par les drones.
Dans la foulée des séismes politiques aux États-Unis, bien des choses surprenantes étaient arrivées. Notamment l’interdiction totale du chocolat, une lubie du Secrétaire à la santé, neveu d’un ancien président. Amoureux fou des golden retrievers, il avait tiqué sur les méfaits supposés de la théobromine, surtout pour les chiens. C’était la substance à abattre, une substance terroriste, et le chocolat fut déclaré substantia non grata. Le trafic du chocolat rapportait maintenant beaucoup plus que celui du fentanyl ou de la coke. Gendron avait été maître-chocolatier dans un grand restaurant de Toronto et il avait, depuis peu, délaissé sa job pour répondre à la demande phénoménale venant du sud de la frontière. Ce soir-là, la cargaison était destinée à un groupe de Mexicains. Il leur manquait cet ingrédient pour la fête des Morts, le 2 novembre. Ils étaient preneurs pour tout ce qu’on pouvait leur apporter. La région des Mille-Îles était prisée pour le trafic, car elle était mal patrouillée par la Garde côtière américaine. Nous sommes partis du motel peu après minuit. Après dix minutes de route, nous étions rendus à la pointe de l’île. On a enlevé la bâche et on a rapidement chargé le bateau. Près de deux cents caisses de chocolat noir. Le petit bateau était plein, et il restait une bonne vingtaine de caisses dans la benne du camion.
– On les prend? a demandé Burns.
Gendron a hésité. Le bateau était déjà chargé au max.
– OK, tant qu’à se donner tout ce trouble. On fera plus de cash.
Une fois les caisses empilées dans le bateau, je les ai bâchées et j’ai arrimé le tout. Burns a démarré le moteur électrique. Nous avancions. Seul le clapotis des vagues contre l’embarcation rompait l’épais silence. Gendron scrutait la rive américaine aux jumelles. Le vent a augmenté brusquement, la houle aussi. Ça tanguait dangereusement.
– Ralentis, tabarnak!
Burns a fait une fausse manœuvre et a plutôt accéléré l’embarcation. Nous avons chaviré. Aucun d’entre nous ne portait de gilet de sauvetage. Au même moment, un puissant projecteur a percé la nuit.
– This is the US Coast Guard!
Je n’ai pas entendu la suite de la mise en demeure. Je n’entendais que les cris désespérés de Burns et Gendron qui se débattaient dans l’eau glaciale. Ils ont coulé à pic. C’était mon tour d’y passer quand j’ai agrippé au dernier moment une bouée. J’ai écopé de vingt ans de prison. Au dessert, il y a souvent du pouding à la caroube, censée remplacer le chocolat. Oh misère.
La non-étroitesse
– Bon, on parle des dimensions dans l’espace. C’est quoi le mot pour désigner quelque chose de large?
L’institutrice balaya la classe d’un regard mou. Puis elle fixa sa montre. Encore deux minutes avant la fin du cours. Paulette leva la main. Elle frétillait sur sa chaise. Elle l’avait le mot. « Qu’est-ce qu’elle va encore me sortir? » pensa l’institutrice.
– Oui, Paulette?
– Largitude.
L’institutrice leva les yeux au ciel.
– Tu n’as pas lu la liste que j’ai donnée hier?
– Oui, j’ai bien vu largeur. Mais largitude, c’est plus joli. C’est un vieux mot français.
– Un archaïsme, bien sûr. Mais aujourd’hui, on n’utilise plus les archaïsmes. La langue évolue.
– Moi j’aime bien les trucs archaïques. Ça sonne comme archanges.
– Ça aussi, ça n’existe pas.
– Je…
La cloche sonna. Ouf, sauvée, murmura l’institutrice.
Vingt ans plus tard, une musique New Age de ’tits oiseaux gazouillants full zen emplissait la salle de loisir, au foyer. C’était la première journée de stage de Paulette McGuire, fraîchement diplômée de l’Université de Sherbrooke en gériatrie. La plus brillante de sa cohorte, son choix avait intrigué tout le monde. « Tu es douée pour la neurochirurgie et ça paie beaucoup. Pourquoi les vieux schnocks? Ils n’ont pas d’argent. » J’aime les vieilles choses, avait-elle répondu avec un sourire désarmant.
Les cours de yoga étaient populaires au foyer, surtout qu’ils étaient donnés par Hugo. Il entra dans la salle, chevelure abondante et assumée, torse bombé, mais juste pas trop pour demeurer en deçà des critères de machisme, il installa les tapis et invita les huit femmes et les deux hommes à s’assoir en lotus. Paulette observait la scène. Une femme maugréa. Elle désigna de la main l’homme à ses côtés.
– Je ne veux pas être à côté de lui. Il pue. J’ai besoin de plus de … Ah, c’est quoi ce mot?
Elle ouvrit grand les bras, et les ouvrit davantage, et encore davantage. Paulette eut un choc. Elle la reconnut. L’institutrice. Atteinte d’Alzheimer précoce, elle était au foyer depuis deux ans. Elle avait à peine cinquante ans. Elle en paraissait vingt de plus. Paulette s’approcha et se pencha vers elle.
– Largitude?
La femme se tourna vers Paulette. Un large sourire illumina son visage.
– Oui, c’est ça, c’est bien ça. Mais vous n’avez pas vu les notes de cours que j’ai distribuées hier?
Une méprise
Julia et Julien étaient jumeaux. Julia avait annoncé à son frangin son retour de Paris plus tôt que prévu. Elle venait d’y passer un an comme stagiaire au Laboratoire Lumière, Matière et Interfaces, à Saclay.
– Nous sommes dus pour une bonne bouteille au chalet, Juju. J’ai des choses à te raconter.
Julien répondit au texto de sa sœur par plusieurs émoticônes de sourire avec lunette de soleil.
– OK. Vendredi prochain à 19 heures. Ciao.
Julia lui envoya un pouce en l’air et retourna à son écran pour finaliser son rapport de stage. Elle fixa longuement le logo du centre de recherches. Lumière, matière, interfaces. Elle se sentait hypnotisée. Les trois mots valsaient sur l’écran. Ils finirent par atterrir dans une zone imprévue de son cerveau, loin des équations de la mécanique quantique. Elle se rappela avoir vu un YouTube sur les expériences de mort imminente et s’était demandé comment on pouvait croire à de telles balivernes. Pour en avoir le cœur net, elle avait enfilé une série de vidéos sur le sujet, qui toutes parlaient de la présence de la lumière. « Que des sottises », avait-elle conclu. Mais là, devant l’écran, le mot lumière avait une signification qui lui échappait, comme si elle découvrait ce mot pour la première fois. Elle eut un frisson. Elle pressentait l’opposé de la lumière. Elle ferma son écran et alla prendre un café au bar d’en face.
Une semaine passa.
Julien se leva, regarda sa montre et alla à la fenêtre pour une cinquième fois. Il tenta de percevoir des phares dans la pluie obstinée qui s’était abattue sur la province depuis deux jours. L’écran de pluie masquait le lac. Un feu vif ronronnait dans le foyer. Il y ajouta une bûche et s’assit. Il reprit le bouquin posé sur le pouf. Crime et Châtiment. On lui en avait recommandé la lecture. « Ça te mettra en contexte », lui avait dit un collègue. Actuaire associé dans un cabinet d’Ottawa, il cherchait à élargir sa palette professionnelle. Il en avait assez des régimes de retraite. Un groupe d’assureurs avait besoin de données à jour sur les homicides. Les poursuites sans fin leur coûtaient cher. Il reprit la lecture à l’endroit où Raskolnikov avoue ses crimes à Sonia. Julien posa le livre sur les genoux. Toute cette noirceur intérieure l’interpellait. Il ressentait une résonance, sans parvenir à y mettre des mots.
Son téléphone bipa.
– Juju, t’es où? Je t’attends depuis une heure.
– Moi aussi. Tu me niaises ou quoi?
– Tu m’attends? Où ça?
– Au chalet.
Au même moment, à deux cents kilomètres de distance, le frère et la sœur réalisèrent leur méprise. Lui était au chalet familial du lac Simon, elle au Chalet Bar-B-Q sur Sherbrooke, à Montréal, qu’ils avaient tellement fréquenté à l’enfance, la famille demeurant à deux pas de la rôtisserie.
– Il pleut chez vous?
– Comme c’est pas possible. Ça manque de lumière.
– Ici aussi. C’est noir.
La maladie
Le médecin a posé son stéthoscope sur le bureau. Il a expiré longuement, puis a remonté ses lunettes sur l’arête fine de son nez. Quel âge avait-il? Trente-cinq ans? J’en avais alors deux de plus que lui.
– Vous êtes un cas rare, monsieur Lefort. Selon les résultats des tests, votre rémission est complète. Il y a deux mois, vous étiez mourant. Cancer avancé de la prostate. Oui, un cas assez rare. Votre cancer s’est développé rapidement, puis les tumeurs se sont résorbées tout aussi rapidement, pouf, comme ça, comme si une poudre magique avait été saupoudrée dessus. Certains parleraient de miracle.
En effet, j’étais en rémission, je sentais mon énergie revenir, mes idées noires s’évaporaient. J’étais entré dans son bureau, tout guilleret, sachant que j’avais droit à de bonnes nouvelles, et je n’avais pas vraiment regardé le médecin. J’avais plutôt les yeux rivés sur mon téléphone, attendant une réponse de Claire à mon invitation à souper. C’est alors que je l’ai vu. Ses traits qui se crispaient à chaque mouvement, son front moite, sa chevelure éparse. Il avait maigri.
– Je suis dans la même situation que vous il y a huit mois. Pour un autre type de cancer. Nos pronostics auront été différents. Vous êtes le dernier patient que je vois. Je cesse ma pratique aujourd’hui. La chimio ne marche pas.
Le téléphone a sonné. Il a répondu, il a hoché de la tête et il s’est levé, pensif.
– Une dernière signature. Je reviens.
Avait-il attrapé le cancer à mon contact? Pensée risible, les cancers ne sont pas contagieux. Peut-être les états d’esprit qui les sous-tendent le sont-ils? Le corps s’imbiberait alors d’une pensée négative et morphogène qui pétrirait les cellules dans le mauvais sens. J’ai trouvé mon raisonnement ridicule. Le médecin est revenu.
– Voilà. Je viens de finaliser un autre dossier. Vous êtes le dernier. Souhaitez-moi bonne chance.
Il s’est levé et m’a tendu la main. Il était grand. Il me donnait l’impression d’un avion qui a perdu son train d’atterrissage. Tout chez lui criait Mayday, Mayday. Je me suis levé. Moi qui ne fais pas trop dans les câlins par nature, je l’ai étreint. J’ai cru percevoir un léger tremblement de ses épaules. Gentiment, il m’a repoussé en désignant la porte. En sortant, je l’ai tirée doucement derrière moi. Mon regard s’est attardé sur l’écriteau portant son nom. Dr Sanschagrin. Il est mort deux mois plus tard.