Après une journée de visite de Rouyn-Noranda voilà que commence mon festival avec trois films le dimanche après-midi, un petit film d’animation, Crème à glace de Rachel Samson, qui ne convainc personne, un deuxième court-métrage, 4 arcanes dansées de Beatriz Mediavilla, célébrité locale puisque j’ai aperçu un panneau sur la rue Principale qui reprenait un des ses bons mots, et un long métrage, La Maison des femmes de Mélisa Godet, qui reçoit un accueil très chaleureux (deux minutes d’applaudissements), et qui raconte la genèse de la Maison des femmes en France où on soigne les femmes victimes de violence. En soirée, Imelda 9 de Martin Villeneuve, le frère de l’autre, qui nous annonce la sortie d’Imelda contrattaque en 2026. Puis 1982 de Juan Carlos Garcia, film qui a remporté le prix du meilleur film au Pérou, et qui raconte un moment de la crise politique qui a secoué le Pérou au cours des années 1980, et enfin, Jeunes mères des frères Dardenne, lauréat du Prix oecuménique plus tôt cette année au Festival de Cannes. Voilà donc le menu de dimanche.
Lundi, on reprend en après-midi avec cinq courts métrages, un film d’animation de France, J’ai avalé une chenille de Basile Khatir, puis quatre petits films produits dans le cadre des programmes d’études du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (Parabellum et Parano) et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (La Vierge de fer et Les Bonnes, le con et le cadavre), puis le long métrage L’Étrangère de Gaya Jiji. En soirée, Courage, un court métrage d’animation de France de 5 minutes avec un réalisateur et cinq réalisatrices (Nathan Baudry, Marion Choudin, Salomé Cognon, Lise Delcroix, Jeanne Desplanques, Margot Jacquet), suivi de Skiff, un « moyen métrage » de 106 minutes de Cecilia Verheyden, et enfin Dossier 137 de Dominik Moll (155 minutes).
Quinze films en deux jours et sept autres aujourd’hui. Première constatation au sujet de la réalisation : on pallie au manque de fonds en masquant l’arrière-plan des scènes par un flou artistique. Dans 1982, une scène où des soldats tabassent des paysans est suggérée par des mouvements flous où l’on ne distingue pas les coups que l’on entend. Dans Skiff, l’arrière-plan est souvent masqué pour cacher la nudité des scènes de douche et de vestiaire, et possiblement pour évoquer la difficulté qu’a Malou, la protagoniste de 16 ans, à accepter son corps, elle qui refuse de prendre une douche après une séance d’entraînement et qui fait que les autres filles la rejettent. Hitchcock nous a bien appris qu’il est plus efficace de suggérer avec des effets sonores que de montrer, n’en déplaise aux amateurs de gore à la Saw. C’est aussi en quelque sorte le propos de Parabellum, ce petit film de cinq minutes où l’on voit des militaires s’entretuer sans que l’on sache vraiment ce qui se passe. Après quelques scènes où l’on voit des soldats se tuer avec des fusils d’assaut, on revoit les mêmes scènes sans bruit mais avec les cameramen qui tournent les plans que l’on vient de voir. Tentative de déconstruction cinématographique qui a dû plaire aux profs de cinéma, bien que le propos soit assez évident, on ne tire pas des vrais balles et on ne meurt pas vraiment au cinéma. Par contre, le montage sonore de la séquence de combat est très réussi, bien qu’il aurait été amusant d’entendre les indications criés aux acteurs par l’équipe de réalisation pendant la reprise avec cameramen.
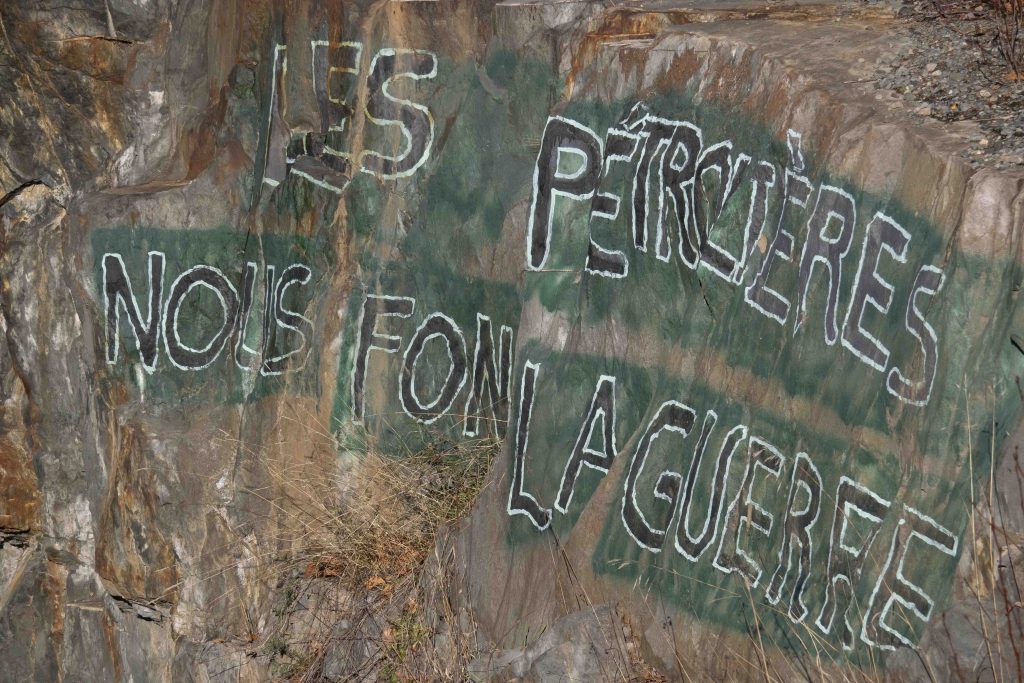


Merci Gilbert pour cette récapitulation très juste.
À quand ton film sur les films?
Lucie
Merci Lucie. Y’a pas de danger que ça arrive.
Le FCIAT, quel événement extraordinaire!